
COMPRENDRE LA MESSE : LA PRÉSENTATION DES DONS
CHAPITRE 12 – Lors de la présentation des offrandes on prépare et apporte les dons qui serviront à la célébration de l’Eucharistie. C’est une transition entre la Parole et l’Eucharistie. En présentant le pain et le vin, c’est toute notre vie que nous présentons au Seigneur, et nous nous disposons ainsi à l’accueillir, écrit l’abbé Pascal Desthieux dans son livre « Au cœur de la messe – Tout savoir sur la célébration » (Ed. Saint Augustin).
La préparation des dons
Avant l’offertoire, il n’y a sur l’autel qu’une nappe qui manifeste que l’autel est bien la table du banquet eucharistique, des cierges qui indiquent que ce repas est sacré, et un crucifix qui rappelle qu’à chaque messe nous sommes au pied de la croix.
Le célébrant dispose d’abord le corporal, un linge blanc carré, appelé ainsi parce qu’autrefois on déposait directement sur lui l’hostie consacrée, le Corps du Christ. Il ajoute un purificatoire, petite serviette pliée, destinée à essuyer le vin consacré et à « purifier » le calice après la communion. Il place encore le missel.
Les vases sacrés
Les servants de messe apportent alors les « vases sacrés » qui vont contenir le Corps et le Sang du Christ. Ils ont des noms un peu compliqués, comme patène, objet de forme circulaire et concave destinée recevoir les hosties pendant la célébration de la messe, le calice ou ciboire. L’origine de ce dernier mot est poétique : kibôrion désigne le fruit du nénuphar et, par extension, la coupe ayant la forme de ce fruit. À la différence du calice, il comporte un couvercle, souvent surmonté d’une croix.
Le pain
Le pain est le « fruit de la terre et du travail des hommes ». Il est aussi un signe d’unité : des grains si divers sont pétris pour ne former qu’une seule farine et un seul pain ! Ainsi la communauté, unifiée par l’action de l’Esprit Saint, communie au même Corps du Christ pour ne former plus qu’un seul corps.
Déjà dans le discours sur le Pain de Vie (Jean 6), Jésus déclare qu’il est « le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et donne la vie au monde » (v. 33), et que ce pain vivant est « sa chair donnée pour la vie du monde » (v. 51).
Nous avons coutume de prendre du pain azyme, du grec a-zumè : « sans levain », c’est-à-dire non levé. Pourquoi ? D’abord en référence à la Pâque juive. Lors du dernier repas qu’il a partagé avec ses disciples, Jésus a pris du pain azyme, et nous voulons faire de même. Il y a aussi des raisons pratiques : il se garde plus longtemps que le pain levé et fait moins de miettes quand on le partage ! Ce pain différent nous rappelle enfin que l’Eucharistie n’est pas un repas comme les autres. Le terme hostie vient du latin hostia qui signifie « victime ». L’hostie désigne donc la victime offerte en sacrifice
Le vin
Lors du dernier repas, en donnant la coupe de vin, Jésus ajoute qu’il ne boira plus désormais « le fruit de la vigne jusqu’à ce que le Royaume de Dieu soit venu ».(Luc 22, 18). En attendant, ce vin sera celui de son sang versé.
Pourquoi utilise-t-on du vin blanc plutôt que du vin rouge ? De nouveau pour des raisons pratiques : le vin blanc tache moins que le rouge.
La procession des offrandes
Ce rite, proposé par la réforme liturgique de Vatican II, renvoie aux premiers temps de l’Église où les chrétiens apportaient le pain, le vin et l’eau, ainsi que la nourriture, pour le repas communautaire, que l’on appelait « l’agape ».
Aujourd’hui, ce ne sont plus les fidèles qui préparent directement le pain et le vin, mais cette procession symbolise la participation de l’assemblée à ce mouvement d’offrande. Nous sommes appelés à nous associer au don que le Christ fait de sa vie, et à nous offrir nous-mêmes avec lui. C’est aussi le monde entier, avec ses souffrances et ses déchirures, que nous remettons dans les mains du Père.
La quête: La quête fait partie, à sa manière, de la présentation des offrandes. L’argent ainsi recueilli est le signe matériel de l’offrande que nous faisons de nous-mêmes et du fruit de notre travail.
La présentation des dons
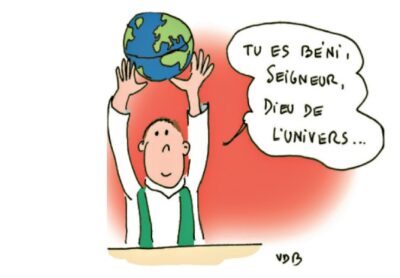
© Hélène VDB
Le prêtre présente les dons à Dieu. Il élève légèrement la patène, puis le calice. C’est un geste parlant pour tous : nos offrandes terrestres, symboles de toute notre vie, sont élevées dans le monde céleste.
Le prêtre prononce des formules de bénédiction qui s’inspirent de la liturgie juive. A la formulation juive de la bénédiction du pain et du vin, le Missel ajoute la mention du « travail des hommes ». À la bénédiction prononcée par le prêtre pour le pain, puis pour le vin, les fidèles sont invités à répondre par une acclamation: « Béni soit Dieu maintenant et toujours. »
La goutte d’eau dans le calice : L’origine pratique de ce geste se trouve dans les coutumes juive et grecque de mêler un peu d’eau au vin qui était trop fort. Mais il y a une signification plus profonde : une fois que l’eau est mêlée au vin, on ne peut plus la distinguer, ni l’enlever. Ainsi en est-il de notre union au Seigneur dans l’Eucharistie : nous ne faisons plus qu’un avec lui.
Seigneur, accueille-nous
Par la suite, le prêtre s’incline dans un geste d’humilité en disant: « Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous : que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. »
Avant d’offrir à Dieu le sacrifice parfait de la nouvelle Alliance, nous reconnaissons notre indignité, mais nous savons que Dieu ne repousse jamais un cœur pénétré d’humilité et de confiance.
Des prières dites à voix basse: Autrefois, une grande partie des prières étaient dites à voix basse (et en latin). Pour favoriser la participation active de tous, le Concile Vatican II a demandé que la plupart des prières soient dites à haute voix. Il reste quelques prières à voix basse, autour de la proclamation de l’Évangile, lors de la présentation des dons et juste avant la communion, que le prêtre prie « en son nom propre, afin d’accomplir son ministère avec plus d’attention et de piété. »
L’encensement des offrandes
Le prêtre encense par la suite les offrandes qui vont devenir le Corps et le Sang du Christ. C’est le signe que nous voulons faire monter nos offrandes vers Dieu comme l’encens qui s’élève.
Le célébrant encense une nouvelle fois l’autel, signe du Christ qui va s’offrir pour nous, et la croix, lieu du sacrifice. Puis le diacre ou le thuriféraire encense le prêtre et les fidèles qui vont s’offrir avec le Christ, afin qu’ils soient eux-mêmes sanctifiés par cette action sainte. Le prêtre se lave ensuite les mains. C’est la reprise d’un geste juif de purification.
En se lavant les mains, le prêtre dit : « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. »
La prière sur les offrandes
En conclusion de la préparation des dons, le prêtre invite l’assemblée à se lever et à prier : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. » Les fidèles répondent : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. »
L’ancienne formule, qui a été conservée dans le Missel en français, étend au monde entier le salut offert par le Christ. Le célébrant dit: « Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.. » « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde », répond l’assemblée.
Suit la prière sur les offrandes qui chante l’admirable échange qui va s’accomplir : les dons que nous offrons à Dieu sont appelés à devenir, par l’action de l’Esprit Saint, Dieu lui-même qui s’offre à nous.
« Nous apportons un peu de pain et de vin ; en retour, toutes les richesses de Dieu nous sont données (…) Nous apportons notre vie, une vie fragile et blessée ; en échange, nous recevons la vie du Ressuscité », conclut l’abbé Desthieux.
Texte d’après le livre de l’abbé Pascal Desthieux « Au coeur de la messe Tout savoir sur la célébration » (Ed. Saint Augustin). Extraits librement résumés.
Les chapitres précédents sont disponibles ICI
Crédit image : Godong
SD&C- ECR, août 2025
